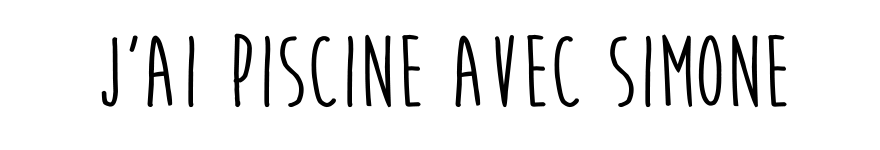Âgée de 52 ans, l’avocate nantaise s’est spécialisée dans la défense des femmes victimes de violences. Une vie à les écouter et à plaider pour elles qu’elle raconte dans son ouvrage « Affaires de femmes » et sur laquelle elle revient pour J’ai piscine avec Simone.
À quoi vous êtes-vous heurtée à force recevoir des femmes victimes de violences dans votre cabinet et de les défendre ?
Je me suis heurtée au système de la domination masculine. Je l’ai compris à force de rencontrer toutes ces femmes qui, les unes après les autres, venaient dans mon cabinet déposer des parcours de souffrances et de violences. J’ai voulu comprendre pourquoi au-delà des milieux sociaux, des couleurs de peau, des religions, des sphères économiques… toutes faisaient l’expérience singulière de la violence et de la domination masculine. Moi-même, ça m’a amenée à interroger ma propre condition de femme et ce que j’avais pu subir. Face à cette expérience empirique, je me suis tournée vers un corpus théorique féministe, qui m’a beaucoup appris et a mis en perspective ce que je ressentais. Cela m’a permis d’apporter des connaissances plus fines dans le prétoire.
« Questionner la société pour dépasser le fait divers »
Dans votre ouvrage, « Affaires de femmes » (octobre 2024, L’Iconoclaste), vous affirmez que vous entremêlez le droit et la politique dans votre pratique. Cela vous a d’ailleurs régulièrement été reproché. Qu’est-ce que ça signifie pour vous, faire de la politique dans un tribunal ?
Cela signifie que je viens y questionner la société. Je pousse les portes du tribunal pour y faire entrer toutes les questions qui nous articulent collectivement, afin de dépasser le cas unique ou le fait divers. Je viens y interroger la norme sociale. Pour moi, c’est ça, faire de la politique : tendre un miroir dans lequel on doit avoir le courage de regarder qui nous sommes et ce que nous produisons collectivement, comme les violences faites aux femmes par exemple. Lors de mes plaidoiries, je viens dire que la singularité du dossier à juger n’est que le reflet d’un système et d’une structure. Mais ce n’est pas moi qui ai inventé cette façon d’amener des réflexions politiques dans le tribunal.
Comment l’institution judiciaire reçoit-elle aujourd’hui ces plaidoiries engagées, politiques ?
Beaucoup mieux. Voire, j’ai parfois la faiblesse de penser qu’elle les apprécie. Et puis je ne suis pas la seule à tenir ce discours-là. Face au néant qu’il y avait auparavant, l’institution judiciaire est au travail sur ces questions-là. Je vois à quel point elle sait parfois être à l’écoute et protectrice. Mais elle manque aussi cruellement de moyens. Or, il faut des moyens, pour prendre le temps d’écouter, de bien considérer celles qui portent plainte. Et là aussi, c’est politique. On ne peut pas à la fois exhorter les femmes à déposer plainte, déplorer le « tribunal médiatique » et en même temps ne pas doter notre justice des moyens nécessaires à sa fonction.
« Mon écoute a évolué, car j’ai eu des expériences douloureuses »
Et vous, comment faites-vous pour accueillir la parole des victimes ? Votre approche a-t-elle évolué avec les années ?
Oui, mon écoute a évolué, car j’ai eu des expériences douloureuses. Des femmes m’ont dit que je ne les avais pas entendues. C’est dur à encaisser. Mais au lieu de considérer qu’elles avaient tort, j’ai essayé de comprendre pourquoi elles pouvaient penser ça. J’ai compris que j’avais pu moi-même proféré des violences. Alors je me suis mise au travail. J’ai beaucoup lu, j’ai appris à décoloniser mon écoute et j’ai essayé de travailler ma méthode. Je commence toujours par ouvrir le champ de la discussion en posant la même question : « Que puis-je pour vous ? » Puis je continue l’entretien avec d’autres questions ouvertes, avant de fermer progressivement et de poser le cadre théorique sur ce que je peux faire pour elles.
Vous avez toujours refusé le huis clos, à l’exemple de l’avocate Gisèle Halimi que vous rappelez dans votre livre et à l’exemple de Gisèle Pélicot, la victime au cœur d’un procès emblématique actuellement. Quel sens mettez-vous dans ce refus ?
Je pars du principe qu’il n’y a aucune raison pour que la victime se sente honteuse de ce qu’elle a subi. Puis, ce n’est pas pour jeter l’opprobre sur les agresseurs, mais le huis clos leur bénéficie de fait, car c’est bien plus facile d’être dans le secret d’un prétoire. Je considère aussi que refuser le huis clos permet d’avoir cette conversation nourrie entre la société et la justice. Que cela permet aux juges d’être en prise avec la société.
« Heureusement, le seuil de tolérance collectif et individuel s’élève contre les violences »
À quoi les femmes de plus de 50 ans victimes de violences font-elles face ? Que remarquez-vous ?
Récemment, j’ai rencontré une femme de 80 ans qui a subi des violences toute sa vie, de la part du père de ses deux garçons. Ses fils étaient parfaitement au courant de ce qu’elles subissaient et tout le monde s’en satisfaisait. La violence à laquelle ces femmes font face questionne qui nous sommes. Quand le corps des femmes n’est plus récréatif, reproductif et valide, la tentation est grande de considérer que ce sont des corps sans valeur et donc, pourquoi les défendre ?
Heureusement, le seuil de tolérance collectif et individuel s’élève contre les violences. Ce sont des voisins qui ont appelé la police quand ils ont vu cette femme sortir de chez elle le nez en sang. Les femmes comprennent aussi davantage qu’elles ont le choix aujourd’hui. Elles sont moins dépendantes économiquement. Elles voient que le sujet des violences est pris au sérieux et se disent « si ça avait existé à mon époque, ça m’aurait aidé ».
Quel impact ce travail a-t-il eu sur vous ?
Il m’a transformée de manière radicale. Je n’ai plus la même lecture du monde, je n’ai plus le même rapport aux autres, je n’ai plus le même rapport aux femmes. Il m’a amenée à m’intéresser aux questions de sororité, que j’essaye d’appliquer dans mon cabinet – où je n’emploie que des femmes – et à participer à la création d’un groupe de femmes, avec lesquelles nous partageons des lectures et des réflexions sur des films. Découvrir la sororité a changé ma vie. C’est très exigeant, mais grâce à ça, je me sens beaucoup plus en cohérence et moins étourdie par mon succès.