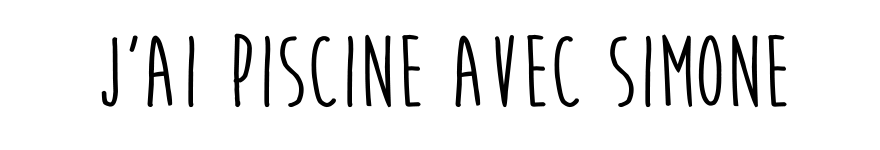Décédée le 9 août 2025 à Henley-on-Thames (Oxfordshire), à 91 ans, l’entrepreneure britannique Stephanie Shirley a posé dès 1962 les bases d’une tech féministe : télétravail, recrutement de femmes, partage de la valeur, lutte contre les biais, philanthropie utile. Que subsiste-t-il de cet héritage — au-delà des hommages — dans les pratiques ?
Télétravail
Son pari : En 1962, Stephanie Shirley conçoit une ESN (Entreprise de Services Numériques) … sans bureaux, des programmeuses à domicile, payées au forfait pour masquer le caractère domestique et partiel du travail. Elle passe de la présence à la performance. Ce cadre ouvre surtout le marché aux mères diplômées évincées des carrières techniques, en leur offrant un modèle compatible avec leurs contraintes réelles. Son entreprise décroche des contrats de premier plan comme le souligne la fondatrice, « Qui aurait cru que la boîte noire du Concorde avait été programmée par 30 femmes travaillant chez elles ? »
Son héritage : Au deuxième trimestre 2024, le télétravail n’est plus une parenthèse, près d’un salarié du privé sur cinq y a recours au moins une fois dans le mois, pour un rythme moyen d’environ deux jours par semaine. Portée surtout par les cadres, la pratique s’est pérennisée depuis la pandémie, soutenue par les accords d’entreprise et un cadre commun qui en facilite la mise en œuvre sans l’imposer.
Recruter massivement des femmes dans la tech
Son pari : Dans une industrie verrouillée par les hommes, Stephanie Shirley choisit la voie la plus radicale, construire une entreprise à écrasante majorité féminine — 297 femmes pour 3 hommes au départ — et démontrer qu’un modèle pensé pour les réalités des vies des salariées peut livrer des projets de tout premier plan. Ses équipes décrochent des contrats sensibles, jusqu’à la programmation de l’enregistreur de vol du Concorde, sans renoncer à ce cadre centré sur les femmes. En 1975, le Sex Discrimination Act met fin aux recrutements explicitement réservés, mais la démonstration est faite, une structure conçue autour des contraintes réelles des femmes peut performer au plus haut niveau.
Son héritage : En France, le « modèle Shirley » reste loin d’être la norme. Dans les professions du numérique, Les femmes représentent désormais près d’un quart des effectifs en 2024 (environ 23 %, d’après l’Insee). Mais lorsqu’on resserre le cadre sur les postes les plus techniques (développement, ingénierie, réseaux), la part chute autour de 15 %. Le phénomène s’enracine dès la formation car les écoles d’ingénieurs ne comptent qu’environ 29–32 % d’étudiantes, tandis que les enquêtes Gender Scan signalent en 2024-2025 une stagnation, voire des reculs dans certaines filières STIM.
Partager la valeur
Son pari : Stephanie Shirley pousse la logique jusqu’au bout en faisant entrer ses salariées au capital. Après avoir cédé le contrôle à son équipe au début des années 1990, l’introduction en Bourse de l’entreprise en 1996 (FI Group, futur Xansa) enrichit certaines collaboratrices, « 70 millionnaires », revendiquait-elle. La fondatrice consolide sa fortune qu’elle donnera ensuite massivement. Au-delà du symbole, c’est une politique économique féministe qu’elle prone, partager la richesse créée et pas seulement les opportunités.
Son héritage : Depuis 2025, les entreprises de 11 à 49 salarié·es doivent mettre en place au moins un dispositif de partage de la valeur (participation, intéressement, prime de partage de la valeur versée sur l’épargne salariale ou abondement à un plan d’épargne) dès qu’elles affichent trois années de suite un bénéfice net au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires. La mesure étend concrètement ces outils aux PME.
En parallèle, les BSPCE (l’équivalent start-up des stock-options, c’est-à-dire un droit d’acheter plus tard des actions à un prix fixé d’avance si l’entreprise prend de la valeur) ont été assouplis en 2024-2025 pour élargir l’accès et clarifier la fiscalité.
Pourtant il reste un angle mort. La France publie peu de données genrées sur l’accès réel à l’equity (BSPCE, actions gratuites). Côté financement, le baromètre SISTA × BCG rappelle que seulement 17 % des montants levés en Europe vont à des équipes avec au moins une fondatrice. Autrement dit, la participation reste un chantier à outiller et à suivre.
Hacker les biais sexistes
Son pari : Confrontée au sexisme, Stephanie Shirley contourne l’obstacle, elle signe ses courriers d’un « Steve » pour obtenir des rendez-vous et des contrats et être prise au sérieux. Le stratagème fonctionne et deviendra l’un des récits fondateurs de sa carrière.
Lire aussi : MONTER SA BOITE POUR CONTOURNER L’ÂGISME EN ENTREPRISE : ENTRE LIBERTÉ ET INSÉCURITÉ
Son héritage : Une ruse toujours d’actualité aujourd’hui. Des expériences “à texte identique, signature différente” en donnent la mesure. en 2015, la romancière américaine Catherine Nichols a envoyé le même manuscrit sous un prénom masculin (« George ») et obtenu bien davantage de réponses positives que sous son propre nom. En 2017, deux collègues, Nicole Hallberg et Martin Schneider, ont échangé leurs signatures d’e-mail : sous identité féminine, les messages recevaient plus d’objections et de condescendance ; sous identité masculine, les échanges se fluidifiaient d’un coup.
Réinvestir : la philanthropie comme politique
Son pari : Après avoir fait fortune, Stephanie Shirley finance la recherche sur l’autisme dont son fils est atteint et développe des services pour l’accompagnement . Elle crée et soutient des structures, fait émerger des équipes, des écoles, des programmes. Sa philanthropie prolonge sa méthode entrepreneuriale, elle investit dans l’infrastructure sociale (soin, éducation, accompagnement ) ce qui libère du temps, sécurise les parcours et rend le travail réellement accessible aux femmes. Un choix moins caritatif que stratégique car sans ces filets, l’égalité reste théorique.
Son héritage : Le mécénat d’entreprise s’est étoffé et les partenariats “impact” se professionnalisent, mais le tissu associatif qui agit au quotidien (santé des femmes, lutte contre les violences, insertion, reconversion, garde d’enfants) demeure financièrement fragile, budgets discontinus, appels à projets courts, peu de pluriannualité. La leçon de Stephanie Shirley est pourtant claire, pour changer l’échelle, il faut des engagements stables, des indicateurs simples (femmes accompagnées, retours à l’emploi, maintien en poste, prévention des ruptures) et des coopérations concrètes entre entreprises et acteurs de terrain. Autrement dit, ce qui tient dans la durée transforme les trajectoires.