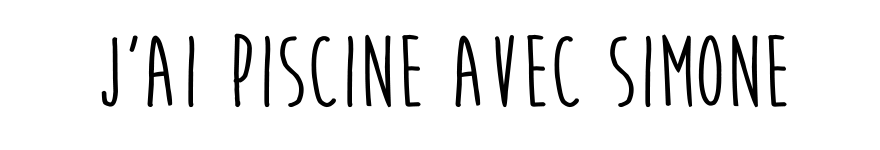Le 10 novembre 2025, le tribunal de Paris a condamné neuf hommes pour cyberharcèlement aggravé contre l’artiste et autrice féministe Typhaine D. Une décision rare et déterminante, qui clarifie enfin la responsabilité pénale de ceux qui participent à des campagnes de haine en meute.
Tout commence en 2022, lorsque Typhaine D est invitée dans Le Crayon Media pour présenter son travail autour de la Féminine Universelle, une langue qu’elle a créée pour rendre visibles les femmes dans la grammaire française. Là où le masculin imposé efface systématiquement les femmes, sa démarche propose de féminiser l’univers linguistique afin de mieux nommer, reconnaître et représenter la moitié de l’humanité.
C’est précisément cette proposition innovante, politique, féministe qui déclenche une réaction en chaîne. En quelques heures, les réseaux sociaux s’embrasent : insultes sexistes, déferlement de moqueries, virilité vexée qui se met au garde-à-vous. L’autrice dit alors subir un « cyberharcèlement de masse », nourri par des centaines d’hommes qui se relaient, par mimétisme ou effet de groupe, pour la faire taire.
Le tribunal a souligné un point crucial, même un seul message, isolé, devient un acte de harcèlement dès lors qu’il s’inscrit dans une dynamique collective déjà en cours. Décision « Sans précédent », souligne Typhaine D. L’idée d’un geste “innocent”, d’une participation “pour rire”, ne tient plus juridiquement. Les juges ont également précisé que « l’ironie ou la satire […] ne les exonèrent nullement de leur responsabilité ». Même constat pour les memes, ces images supposément “humoristiques”, eux aussi peuvent relever du harcèlement.
Des peines conséquentes
Les neuf hommes ont été reconnus coupables de harcèlement moral aggravé commis par voie numérique. Pour sept d’entre eux, le caractère misogyne des attaques fondé sur le sexe de la victime a été retenu comme circonstance aggravante. Certains ont également été condamnés pour menace de mort, menace de viol ou incitation à la violence.
Les peines sont individualisées mais fermes : amendes parfois élevées, inéligibilité, stages obligatoires sur la citoyenneté numérique et versement d’indemnités pour réparer les préjudices moral et physique. Ces violences ont laissé des traces profondes. L’artiste harcelée raconte son « stress post-traumatique », son « hypervigilance » et les difficultés cognitives qui ont suivi des mois d’attaques incessantes.
Messieurs « tout le monde »
L’un des aspects les plus marquants de l’affaire est la diversité des profils condamnés. « Contrairement aux préjugés, ces hommes ont des profils divers », insiste l’artiste. Ingénieur, caviste, boulanger, coach sportif, ancien militaire, certains en couple, d’autres pères de famille, plusieurs se disant même… féministes. La violence en ligne n’est pas l’apanage d’une marge sociale ; elle traverse toutes les catégories. « Leur seul point commun ? Ce sont tous des hommes. Des hommes qui décident de se défouler en meute contre des femmes qui s’expriment librement. » Une formulation qui donne la dimension systémique du cyberharcèlement misogyne.
À l’approche de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, cette décision rappelle que les violences numériques ne sont pas un “hors-champ” : elles s’inscrivent dans le continuum des violences masculines. La justice envoie un message clair, ce qui se passe en ligne relève du droit, et les femmes doivent pouvoir parler, créer, débattre sans craindre la meute. « Les femmes doivent pouvoir s’exprimer librement dans cet espace public du numérique qui est tout autant à elles qu’aux hommes. » insiste Typhaine D.
Les condamnés ont dix jours pour faire appel. De son côté, Typhaine D poursuit son suivi psychologique et continue, malheureusement, de recevoir des attaques. Un deuxième procès est prévu en septembre 2026 contre d’autres mis en cause, tandis que les mineurs au moment des faits seront jugés par des tribunaux spécialisés. « La bataille continue donc », dit-elle simplement.