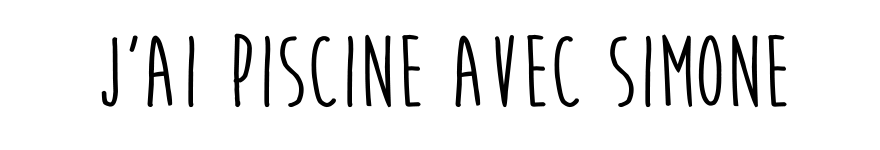L’Observatoire de l’émancipation économique des femmes (Fondation des Femmes) publie une note consacrée à la retraite des femmes. Un sujet encore peu traité alors qu’il révèle des écarts majeurs entre femmes et hommes. Co-rédactrice avec Elsa Foucraut, la sociologue et dirigeante de Mixing Générations, Melissa-Asli Petit nous en explique les enjeux.
Pourquoi avoir travaillé sur ce sujet ? La retraite des femmes était-elle absente du débat public jusqu’ici ?
Pour l’Observatoire de l’émancipation économique des femmes, porté par la Fondation des Femmes, il y a eu cette réflexion sur le parcours de vie. Les notes précédentes portaient sur la fin de carrière ; sur les aidants et sur la maternité. Il y a donc une logique d’ensemble, et le sujet qui manquait, c’était la retraite. C’est une réflexion générique sur l’ensemble du parcours de vie, et la retraite est un angle mort. D’un point de vue systémique, il y a un manque de politiques publiques et un manque de débat. Même si, et on le dit dans la note, il y a une forme de visibilisation un peu plus forte dans le débat public depuis 2023, il y a encore besoin de porter ce sujet davantage et de le rendre vraiment visible.
Est-ce que la retraite est la somme de toutes les inégalités accumulées au fil de la vie des femmes, au point que cela finit par exploser à ce moment-là ?
C’est tout à fait ça, une accumulation des inégalités sur l’ensemble du parcours de vie, et la retraite amplifie ces inégalités. Ce sont les inégalités salariales hommes-femmes, les parcours d’emploi souvent hachés, les questions de fin de carrière qui touchent plus les femmes — ni en emploi ni en retraite — et une protection sociale pensée sur un modèle qui est défaillant pour le féminin. À la retraite, tout cela s’exacerbe, avec des écarts de revenus symptomatiques. C’est vraiment ce miroir grossissant des inégalités.
À quel moment ces inégalités se construisent-elles réellement ? Au premier enfant ?
Alors c’est sûr qu’avec le premier enfant, on voit les problématiques salariales qui s’accélèrent. Il y a un parcours féminin inscrit dans des inégalités, mais on peut aussi ne pas avoir d’enfants et devenir aidante d’un parent âgé. Dans le parcours, les inégalités se construisent. Toute la retraite a été pensée dans l’écosystème familial de 1945, où l’homme, avec son emploi à vie, devait assurer les revenus du foyer. Cet écosystème ne tient plus aujourd’hui, avec l’évolution familiale, les divorces, les séparations, les familles monoparentales et les carrières non linéaires.
S’y ajoute le passage des dix meilleures années aux vingt-cinq meilleures années pour le calcul, qui dilue la pension des femmes. Et les réformes qui repoussent l’âge légal aggravent encore cet effet. Les hommes, avec des salaires plus continus, peuvent plus facilement s’en sortir ; alors que pour les femmes, et pour les classes populaires, les parcours fragmentés se retrouvent directement dans le niveau de retraite.
Le travail du care doit-il être intégré différemment ?
Il faut évidemment engager une vraie réflexion sur la manière de reconnaître et de valoriser ce travail gratuit, qui est essentiel, surtout dans une société de la longévité. On sait que les femmes sont plus souvent aidantes, qu’elles soient en activité ou à la retraite, et que cela a un impact réel sur leur santé. Les dispositifs publics, eux, restent insuffisants financièrement comme humainement. Au-delà de la reconnaissance, c’est une question de vision de société. Nous vivons dans une époque d’accélération et d’urgence permanente, alors que le travail du care, du lien et du cœur, nous oblige à repenser la lenteur, le temps et la valeur du relationnel. C’est un changement de regard, de rythme et de priorités, difficile à opérer, mais indispensable dans une société du vieillissement.
Vous évoquez dans le rapport des mécanismes compensatoires bâtis sur des normes patriarcales. Pouvez-vous expliquer en quoi ces dispositifs perpétuent les inégalités plutôt que de les corriger ?
Oui, alors pour comprendre ces mécanismes compensatoires, il faut revenir un peu en arrière. On distingue les droits propres, acquis par le travail, et les droits dérivés, liés à la maternité ou au veuvage. Ces mécanismes ont longtemps été essentiels pour les femmes, notamment celles nées avant la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup ont pu vivre dignement grâce à la pension de réversion. Certaines percevaient 600 euros de retraite personnelle, mais atteignaient 1 400 euros grâce à celle de leur mari. Ce système, construit dans un modèle patriarcal où l’homme était le titulaire principal du droit, révèle une injustice, tout en jouant un rôle d’amortisseur des inégalités et en permettant à de nombreuses femmes de vivre décemment.
Les mécanismes compensateurs sont-ils encore adaptés aujourd’hui ?
La question aujourd’hui est de savoir comment repenser ces mécanismes dans une société où le mariage n’est plus la norme, où les parcours conjugaux sont plus variés. Il faut réinterroger aussi les droits familiaux liés à la maternité. Car ces dispositifs peuvent certes améliorer le niveau des pensions, mais ils reposent encore sur une vision nataliste car à partir de trois enfants, une bonification de 10 % s’applique pour les deux parents. Ce principe — “plus vous avez d’enfants, mieux c’est pour la société” — montre bien à quel point notre système reste marqué par une logique de genre et de reproduction sociale.
Ces réformes aggravent-elles la situation des femmes ? Et comment analysez-vous ce “no woman’s land” de 15 ans entre 50 ans et l’âge effectif de départ ?
Oui, les études, notamment celles de l’économiste Michaël Zemmour, montrent que l’allongement de l’âge de départ pénalise davantage les femmes et les classes populaires. On parle beaucoup de cette zone grise de fin de carrière : que fait-on entre 50 et 64 ans, alors que les femmes partent déjà, en moyenne, huit mois plus tard que les hommes ?
Comment expliquez-vous que ce no woman’s land ne soit jamais intégré dans la conception des réformes ?
Il n’y a pas, dans les politiques publiques, de réflexion globale sur cette période. Les réformes se succèdent sans cohérence, ni réelle étude d’impact. Or, si la retraite et l’emploi ne sont pas pensés ensemble, on crée mécaniquement des effets négatifs sur les femmes. Il faut articuler une politique de retraite avec une politique d’emploi. Historiquement, la sortie précoce du marché du travail à 55 ans puis la retraite à 60 ans avaient instauré une culture de la fin de carrière. Aujourd’hui, en repoussant encore l’âge légal, on prolonge ce déséquilibre sans repenser le système. Les deux doivent aller de pair et être évalués à chaque réforme.
Pourquoi la culture d’entreprise reste-t-elle figée sur cette vision : à 60 ans, c’est fini ?
Je ne sais pas ce qui fera vraiment bouger les lignes, même si je constate certaines avancées. Dans une société de la longévité où les frontières entre âges sont moins rigides qu’autrefois, la question est de savoir comment les politiques publiques peuvent aménager des transitions plus souples, par exemple en valorisant la retraite progressive, y compris pour les indépendants et comment le marché du travail peut reconnaître la valeur de chaque âge sans en stigmatiser un autre. Il existe aujourd’hui de vraies dérives. Je suis parfois choquée par ce que j’entends de la part de jeunes à propos des plus âgés. C’est le signe d’un modèle de société qui s’épuise, enfermé dans sa roue du hamster, allant trop vite et vivant dans des bulles qui ne se confrontent plus à la différence.
Penser la fin de carrière et l’allongement de l’âge de départ, c’est aussi repenser les relations entre générations. Cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas avoir de proximités, de valeurs ou de personnalités, mais cela suppose une réflexion collective sur la place de chacun dans le temps long du travail.
Les carrières non linéaires et la démographie obligent-elles à repenser le système ?
Oui, tout à fait. Comme le montre la “New Map of Life” de Stanford, il faut sortir d’une société du “ou” soit en emploi, soit en formation, soit à la retraite pour aller vers une société du “et”. Cela suppose de la souplesse et des politiques publiques qui permettent de se former ou de changer de voie à tout moment de la vie. On peut aujourd’hui être salarié quelques jours par semaine et exercer une autre activité à côté. L’enjeu, c’est de valoriser non pas l’âge, mais l’expérience. Les compétences s’acquièrent avec le temps et ne disparaissent pas. Ce changement de regard doit s’accompagner tout au long du parcours, et pas seulement à l’approche de la retraite.
Quelles recommandations sont, pour vous, les plus essentielles, pour amorcer un changement ?
Notre première recommandation, c’est d’accompagner toute future réforme des retraites d’une véritable réforme pour l’égalité femmes-hommes dans l’emploi. La deuxième porte sur le relèvement du minimum vieillesse. Enfin, la troisième touche à la question de la dignité, il faut s’interroger sur la dignité que notre société souhaite garantir à chacun.
Quand vous parlez de dignité, vous parlez aussi de décence. Qu’entendez-vous exactement ?
Oui le mot “décence” est juste. Quelle décence on veut donner, et on veut garantir ? Il y a un double discours : “les retraités sont très riches” et, en même temps, ils doivent se débrouiller seuls, notamment pour leur perte d’autonomie. Mais il y a quand même plus de 5 millions de personnes qui gagnent moins de 1000 euros. Qu’est-ce qu’on fait pour eux ? Ce n’est pas avec moins de 1000 euros qu’on peut avoir une vie décente, surtout en fin de vie, ou en perte d’autonomie. Je pense que c’est la décence et la dignité de la société qui se jouent là.
Que peuvent faire, dès aujourd’hui, les femmes actives pour ne pas subir ces inégalités à la retraite ?
Au-delà des politiques publiques, chaque femme peut réfléchir à la manière de se construire un filet de sécurité pour sa retraite. Anticiper, c’est aussi penser à son autonomie financière et patrimoniale. Posséder un bien, épargner ou investir, c’est une façon de garantir son indépendance future. Cette réflexion devrait faire partie de notre éducation, car l’autonomie économique reste une condition essentielle de l’émancipation.
Cette conscience de devoir se protéger financièrement vient souvent de la culture familiale, mais elle n’est pas partagée par toutes les femmes ?
Exactement. C’est notre histoire familiale, notre héritage de femmes, qui rend cette question importante. Si j’étais née dans une autre génération, les choses auraient sans doute été différentes, car notre société n’éduque pas les femmes à interroger leur propre patrimoine. Les politiques publiques ont accompagné notre émancipation, mais il nous revient aussi, individuellement, de prendre du pouvoir sur nos vies en comprenant que notre autonomie passe, très concrètement, par un toit.
Avez-vous eu des réactions institutionnelles à votre rapport ?
Il faut bien sûr réussir à faire bouger les pouvoirs publics, même si le contexte politique reste instable. Si une réforme systémique des retraites doit être engagée, elle devra avancer par étapes, avec des choix clairs et une communication transparente sur les objectifs et les impacts. La pension de réversion demeure, pour beaucoup de femmes, un dispositif essentiel : il faut la préserver tout en repensant le système pour les générations à venir, afin qu’elles cessent de penser qu’elles n’auront jamais de retraite.
Ce qui manque aujourd’hui, c’est une véritable vision d’ensemble — une vision de société porteuse d’espoir et de sens. Quand on parle de décence et de dignité pour les femmes aux petites retraites, cela ne devrait même pas faire débat.