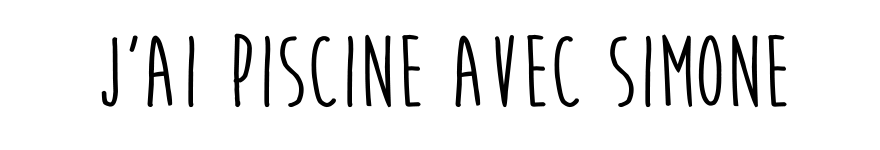Au cours d’un échange public, Michelle Obama a estimé que les États-Unis « ne sont pas prêts pour une femme présidente ». Une déclaration qui renvoie à la dernière élection présidentielle et aux obstacles structurels qui freinent encore l’accès des femmes — et des femmes racisées en particulier — aux plus hautes fonctions du pays.
Le 5 novembre 2025, sur la scène de la Brooklyn Academy of Music à New York, Michelle Obama est venue présenter son livre The Look. Interrogée sur l’idée d’une éventuelle candidature à la Maison-Blanche — une hypothèse qui revient régulièrement dans le débat public — l’ancienne Première dame a livré un constat direct : « Les États-Unis ne sont pas prêts pour une femme présidente. » ajoutant :
« Il existe encore, malheureusement, beaucoup d’hommes qui ne pensent pas pouvoir être dirigés par une femme. Et nous l’avons vu. » Une référence transparente à l’élection présidentielle de 2024, qui opposait Kamala Harris à Donald Trump et s’est soldée par la défaite de la candidate démocrate.
Les propos de Michelle Obama font écho à un phénomène que les sciences sociales décrivent depuis des années, malgré des décennies de débats sur la parité, les États-Unis n’ont jamais élu de femme à la présidence. Ce plafond n’empêche pas l’existence de femmes puissantes dans l’appareil politique américain. D’autres figures ont marqué la vie politique américaine. Madeleine Albright, première femme secrétaire d’État (nommée en 1997), Condoleezza Rice, seconde femme — et première femme noire — à occuper ce poste (2005), Hillary Clinton, candidate démocrate en 2016, qui a remporté le vote populaire mais perdu l’élection en raison du collège électoral. Ces trajectoires montrent que les femmes parviennent à accéder à des fonctions très élevées mais l’accès à la présidence reste verrouillé.
Le « double standard » pour les femmes en politique
La recherche américaine documente ce biais depuis plus de vingt ans. Le double standard appliqué aux femmes politiques est largement étayé par les travaux de la Barbara Lee Family Foundation, qui montre que les femmes doivent simultanément prouver leur compétence et leur chaleur, alors que les hommes ne sont évalués que sur la compétence. La linguiste et professeure Deborah Tannen (Georgetown University) résume ce mécanisme ainsi : « Une femme qui parle avec autorité est perçue comme agressive. Une femme qui parle avec douceur est perçue comme faible. Dans les deux cas, elle est pénalisée. ». Une étude du Center for American Women and Politics confirme que les femmes candidates sont jugées sur des critères supplémentaires — ton de la voix, apparence, empathie — qui n’entrent pas en ligne de compte pour les candidats masculins.
L’affiche Harris–Trump de 2024 est devenue, pour beaucoup de commentateurs et de chercheuses, un cas d’école sur les limites du leadership féminin aux États-Unis. Propulsée candidate en quelques semaines après le retrait de Joe Biden, Kamala Harris a mené une campagne express de 107 jours face à un adversaire archi-connu, déjà ancien président, dans un climat politique extrêmement polarisé.
Le cas Kamala Harris
Les urnes confirment l’existence d’un fossé de genre, les femmes ont, dans leur ensemble, davantage voté pour Harris, tandis qu’une majorité d’hommes ont choisi Donald Trump. Mais ce soutien féminin n’a pas suffi à compenser les bascules observées dans d’autres électorats, notamment chez une partie des électrices et électeurs hispaniques et chez les jeunes hommes, plus nombreux qu’en 2020 à se tourner vers le candidat républicain.
Plusieurs travaux commencent à analyser la défaite de Harris en croisant le genre et la race. Une note de recherche montre que, par rapport à 2020, les démocrates n’ont pas réussi à tirer parti du profil d’une candidate femme et noire. Les gains attendus dans les États où les femmes et les électeurs afro-américains sont nombreux ne se sont pas matérialisés, tandis que les reculs ont été marqués dans les États comptant un électorat hispanique important. Dans un panel d’expertes noires organisé après le scrutin, plusieurs participantes vont plus loin et parlent de misogynoir – la combinaison de racisme et de sexisme – pour décrire la façon dont la candidate a été attaquée et perçue pendant la campagne.
Le poids du racisme, obstacle supplémentaire pour les femmes noires
Ce diagnostic est partagé par des voix issues du camp démocrate. Dans son livre Independent, l’ancienne porte-parole de la Maison-Blanche Karine Jean-Pierre explique qu’elle n’a jamais vraiment cru que Harris pourrait gagner, non par manque de compétence, mais parce qu’elle doutait que le pays soit prêt à élire une présidente qui lui ressemble : « J’ai été dans le corps d’une femme noire toute ma vie », écrit-elle, en évoquant un climat durable de racisme et de sexisme. Sur le terrain, les élues noires racontent toutes la même chose, la couleur de leur peau et leur genre pèsent dans chaque interaction politique.
Au-delà des biais qui touchent toutes les candidates, elles doivent affronter un registre de stéréotypes qui leur est propre. Le Center for American Women and Politics observe depuis plusieurs années que les femmes noires sont plus souvent perçues comme « colériques » ou « dures » que les autres, des étiquettes qui les placent d’emblée en décalage avec la figure traditionnelle et encore largement masculine du président. Dans ce contexte, les mots de Michelle Obama prennent une résonance particulière. Quand elle affirme que les États-Unis « ne sont pas prêts pour une femme présidente », beaucoup y entendent aussi le reste de la phrase, jamais prononcée mais omniprésente : encore moins pour une femme noire.