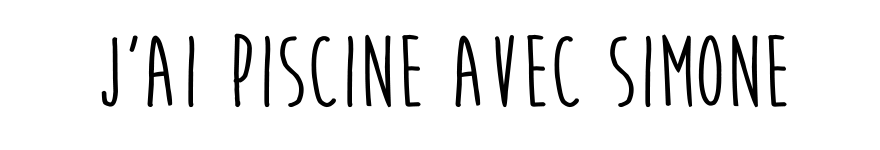Une étude de l’université d’Oxford et l’University College London souligne une tendance préoccupante : les générations nées après 1945 seraient en moins bonne santé que leurs aînés au même âge. Avec un vieillissement accéléré, cette observation pose de nouveaux défis pour la santé publique.
Le vieillissement de la population s’accélère à l’échelle mondiale. Selon l’ONU, près de 20 % des habitants auront 65 ans et plus d’ici 2050. En Europe et aux États-Unis, cette transition démographique est déjà bien avancée avec le vieillissement de la génération du baby-boom, ce qui entraîne une demande accrue de soins de santé. Si l’espérance de vie a longtemps été synonyme de meilleure santé, les avancées depuis les années 1980 ont réduit les incapacités chez les personnes âgées, laissant espérer un vieillissement en meilleure forme.
Pourtant, les études montrent une réalité plus contrastée. En analysant les tendances de santé et d’invalidité des générations nées avant et après la Seconde Guerre mondiale, les chercheurs ont mis en évidence une « dérive générationnelle de la santé ». Les générations nées après 1945 sont en moins bonne santé que leurs aînés au même âge, avec une augmentation significative de maladies chroniques comme le diabète et l’hypertension, en hausse de plus de 20 % aux États-Unis (Beltrán-Sánchez et al., 2016).
Une « dérive générationnelle de la santé » avec des différences régionales marquées
L’Europe n’échappe pas à cette tendance, même si la comparaison avec les États-Unis reste complexe en raison des différences méthodologiques. Si les limitations de mobilité ont reculé, la baisse de l’invalidité, constatée chez les générations d’avant-guerre, a ralenti, voire s’est inversée pour celles nées après 1945. Adapter les politiques publiques à ces nouvelles réalités est crucial pour répondre aux besoins d’une population vieillissante, dont la santé devient de plus en plus hétérogène.
La situation se confirme : les maladies chroniques, telles que le cancer et les maladies pulmonaires, sont en hausse dans les nouvelles générations. Aux États-Unis, la prévalence de la multimorbidité chez les personnes âgées a bondi de 32 % entre les années 1980 et 2020. Cependant, cette évolution varie selon les régions, influencée par des facteurs comme les habitudes de vie et l’accès aux soins. Ainsi, la baisse de la mortalité par cancer du poumon chez les hommes, liée au recul du tabagisme, a débuté dès les années 1920 aux États-Unis, mais seulement dans les années 1950 dans le sud de l’Espagne.
Stagnation de la santé physique et enjeux pour les politiques publiques
Pour les générations nées après 1945, la tendance est à la stagnation, voire à la régression en matière de santé physique. Entre 1946 et 2020, les Anglais nés après la Seconde Guerre mondiale n’ont pas connu les mêmes progrès que leurs aînés en termes de limitations de mobilité, contrairement aux générations précédentes qui avaient enregistré une amélioration de 15 % sur la même période. Cette situation s’explique en partie par une hausse de la multi-morbidité et de l’obésité, ainsi que par des évolutions dans le monde du travail et les pratiques médicales. La force de préhension, un indicateur de la robustesse physique, a chuté de 10 % chez les jeunes générations dans certaines régions, suggérant un vieillissement plus fragile pour ces dernières.
Les raisons de cette « dérive générationnelle » sont multiples et difficiles à isoler. Les évolutions des diagnostics médicaux, une plus grande sensibilisation aux questions de santé et des pratiques de déclaration plus ouvertes ont certainement un impact. Pourtant, la priorité est claire : mieux comprendre ces tendances pour adapter les politiques publiques. Avec 21,1 % de la population européenne âgée de plus de 65 ans en 2020, il devient urgent de réévaluer les stratégies pour mieux accompagner le vieillissement, face à une situation de santé de plus en plus hétérogène.
Lire aussi : SILVER ÉCONOMIE : UN ATOUT POUR LE VIEILLISSEMENT ?