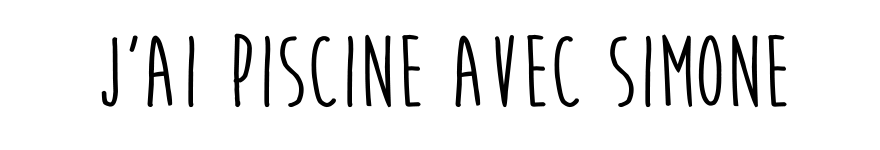À l’occasion du Festival du cinéma américain de Deauville, plusieurs films rares d’Alice Guy ont été projetés. Première réalisatrice de l’histoire du cinéma, elle a pourtant été reléguée aux marges des récits officiels. La journaliste Véronique Le Bris, fondatrice du prix éponyme, a présenté cet hommage et rappelle combien il est urgent de redonner à cette pionnière, féministe avant l’heure, la place qu’elle mérite.
Alice Guy a longtemps été écartée de l’histoire officielle du cinéma, alors qu’elle en fut l’une des fondatrices. Entre 1896 et 1906, elle tourne plusieurs centaines de films et montre que le cinéma peut être plus qu’une simple captation du réel, un art du récit et de la mise en scène. « Elle était présente dès les débuts, au même moment que les frères Lumière, et à la même hauteur qu’eux dans l’invention du cinéma », rappelle Véronique Le Bris. Pourtant, son nom, absent des manuels, illustre combien la contribution des femmes a été minimisée, voire effacée. Pour la journaliste, « l’injustice est insupportable ». Réhabiliter la réalisatrice, c’est reconnaître qu’une autre histoire du cinéma a bel et bien existé, et qu’elle l’a écrite dès l’origine.
Jamais Alice Guy n’a revendiqué un engagement féministe. Mais ses films suffisent à témoigner. « Dans 95 % de ses films, le personnage principal est une femme qui ne se résout pas à un rôle de potiche », insiste Véronique Le Bris. Qu’elles soient mères, employées, amantes ou héroïnes comiques, ces femmes tiennent l’intrigue et font avancer l’action. Elles travaillent, trompent, se font tromper, assument leur désir ou leur exaspération face à la charge mentale.
Une pionnière aux origines du cinéma
La pionnière ose aborder des thèmes tabous : l’avortement, la traite des blanches, le désir féminin. Dans La femme collante (1906), elle montre une femme enceinte qui « ne s’empêche pas de se comporter comme une badass, qui pique une sucette à une petite fille ». Loin de l’archétype de la maternité sacralisée, elle filme des femmes faillibles, désirantes, audacieuses. « C’est fou, souligne Véronique Le Bris, parce que ce sont des sujets qu’on ne voit toujours pas traités aujourd’hui. ». L’humour traverse aussi son œuvre, qualité rarement associée aux femmes à l’époque. Dans ses films, les héroïnes se distinguent par leur indépendance et, parfois, les petites filles deviennent elles aussi des personnages centraux. « Tout à coup, ce sont elles qui deviennent le pivot de l’histoire », note la journaliste.
Si Alice Guy a marqué l’histoire par ses récits, elle a aussi bouleversé le langage cinématographique. Dès ses débuts, elle introduit une véritable scénarisation, quand beaucoup se contentent encore d’images fixes ou d’anecdotes visuelles. Autodidacte, elle se forme à la photographie, apprend à manipuler les appareils auprès de techniciens chevronnés et expérimente les surimpressions, les illusions d’optique, les effets spéciaux. « Elle savait faire marcher quelqu’un sur l’eau, elle avait appris aux autres ces effets-là », raconte sa biographe.
Une inventrice du langage cinématographique
Elle est surtout la première à explorer le cinéma sonore. Dès 1902, Léon Gaumont dépose un brevet de synchronisation de l’image et du son : c’est elle qui prend en charge les tournages, réalisant plus d’une centaine de films courts chantés ou opératiques. « Officiellement, le cinéma sonore naît en 1927 avec Le Chanteur de jazz. Elle, elle avait 25 ans d’avance », souligne Véronique Le Bris. Lorsqu’elle arrive aux États-Unis, elle a déjà dix ans d’expérience derrière la caméra et une longueur d’avance sur les techniciens américains. Pourtant, plus d’un siècle après, il reste difficile de mesurer pleinement l’ampleur de ses apports, tant son œuvre nous est parvenue de manière incomplète.
Plus d’un siècle après ses débuts, l’héritage d’Alice Guy demeure fragile, dispersé entre fonds d’archives et copies rares. « Aujourd’hui, on estime qu’il y a environ 150 films d’elle en état d’être vus, dont une soixantaine vraiment exploitables », précise Véronique Le Bris. Les productions réalisées chez Gaumont sont pour la plupart conservées et restaurées, mais celles de son studio américain Solax ont payé un lourd tribut : deux incendies ont détruit une partie des bobines.
Une œuvre précieuse et fragile
La Library of Congress (Washington, D.C) détient plusieurs de ses films américains, numérisés mais mal restaurés. « Ils existent, on peut les voir en ligne, mais ça mériterait un vrai travail de restauration, qui coûte très cher », regrette la journaliste. Résultat : leur diffusion reste confidentielle. De belles surprises continuent pourtant de surgir. En mai 2024, un film inédit a refait surface chez un antiquaire en Italie : La Esmeralda (1905), adaptation de Notre-Dame de Paris racontée du point de vue de l’héroïne. « C’était incroyable de voir ce film, avec des images en bon état, même s’il manque une seconde à la fin. TCela prouve qu’en cherchant encore, on peut en retrouver d’autres», souligne Véronique Le Bris.
Si Alice Guy doit sa première chance à Léon Gaumont, ce dernier ne l’a pas protégée durablement. Dirigeant des équipes d’hommes, elle suscite jalousies et hostilité. « Elle raconte qu’on lui brûlait ses décors, que certains abusaient de ses actrices. Forcément, ça créait des tensions », souligne Véronique Le Bris. Gaumont, lassé de devoir arbitrer ces conflits, trouve une issue au moment opportun, Alice vient de se marier, son mari est envoyé aux États-Unis pour développer le marché, et elle le suit.
Un effacement progressif
À distance, les liens restent cordiaux, mais l’histoire officielle s’écrit sans elle. Quand Gaumont publie ses mémoires, il ne mentionne qu’un seul de ses films, La Passion. « Tous les hommes de son entourage ont reçu la Légion d’honneur dans les années 1920. Elle, elle a dû attendre 1957 », glisse la fondatrice du prix Alice Guy. Cette reconnaissance tardive n’intervient que grâce au fils de Gaumont qui, en écrivant sur son père, redécouvre qu’Alice Guy fut la figure la plus marquante de cette époque. Ainsi s’installe l’oubli par une mise à distance progressive. « Elle a souffert d’un intérêt sporadique, on la redécouvre, puis elle disparaît », résume la journaliste. Quelques grands cinéastes ont pourtant reconnu sa modernité. Eisenstein s’inspire de ses mises en scène pour Le Cuirassé Potemkine, et Martin Scorsese lui rend hommage lors d’une rétrospective au Whitney Museum à la fin des années 2000. Mais ces gestes demeurent isolés, incapables de compenser son absence des récits officiels.
L’existence d’Alice Guy épouse les soubresauts d’un destin sans cesse remis en question. Née en France, benjamine d’une fratrie de cinq, elle voit le jour parce que sa mère, installée au Chili avec son mari libraire-éditeur, a choisi de revenir accoucher en métropole. Ce va-et-vient entre continents laisse une empreinte durable : « Ses parents ont fait fortune en Amérique du Sud avant de revenir ruinés. Et elle connaîtra le même destin en Amérique du Nord, un studio flamboyant, puis la faillite », raconte Véronique Le Bris. Elle-même reconnaissait ce parallèle, confiant que « dans [sa] famille, on réussit au-delà des autres, mais on se ruine au-delà des autres aussi ». Sans plan de carrière, elle avance par rebonds successifs, « Elle n’a pas de trajectoire linéaire. Mais chaque occasion, elle la saisit et la transforme en palier pour avancer », observe-t-elle.
Alice Guy a tout fait pour transmettre. L’une des rares réalisatrices de son époque à avoir écrit son autobiographie, elle laisse un témoignage unique. « Même là-dessus, elle a un temps d’avance », souligne Véronique Le Bris. Pour prolonger cet héritage, la journaliste a créé en 2018 le Prix Alice Guy, qui distingue chaque année une réalisatrice. « C’était vital, confie-t-elle. Parce qu’entre 1896 et 1906, c’est le seul témoignage filmé par une femme qui existe au monde. Elle nous montre sa vision de la société. C’est abyssal. »