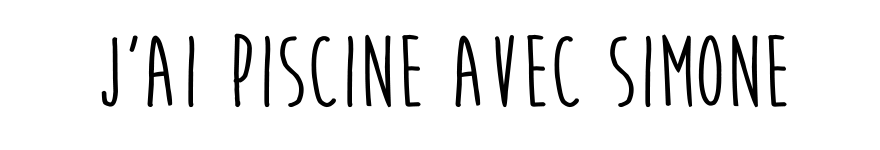À l’heure où vieillir est souvent vécu comme un isolement, l’amitié intergénérationnelle entre femmes surgit comme une forme puissante de résistance collective. Ce n’est pas un simple lien d’émotion personnelle mais un engagement féministe concret, fondé sur la transmission, la solidarité et la remise en cause du système âgiste.
Des chercheuses comme Suzanna Rose, psychologue sociale américaine spécialisée dans les dynamiques de genre et fondatrice du Center for Women’s and Gender Studies à Miami, et Laurence Bachmann, sociologue suisse connue pour ses travaux sur les rapports sociaux de sexe et les inégalités de pouvoir, ont mis en lumière le rôle crucial des amitiés féminines — en particulier lorsqu’elles sont intergénérationnelles. Leurs recherches montrent que ces liens ne relèvent pas uniquement du registre affectif, ils permettent aux femmes de sortir de l’isolement, de nommer les violences structurelles qu’elles subissent, et de puiser de la force dans le collectif pour construire des formes concrètes de résistance.
Dans une autre perspective, les militantes et chercheuses indiennes Nithila Kanagasabai et Shilpa Phadke, toutes deux engagées de longue date dans les luttes féministes intersectionnelles, ont décrit dans leur article Forging Fraught Solidarities (2023) comment, en Asie du Sud, les mouvements féministes s’appuient sur des amitiés transgénérationnelles pour remettre en cause les logiques de domination liées à l’âge, à la caste ou à la classe sociale. Ces liens ne sont pas anecdotiques : ils deviennent le terreau de coalitions politiques joyeuses et résilientes, capables de bousculer les rapports de pouvoir, autant dans la sphère militante que dans les relations personnelles.
L’impact émotionnel des connexions entre les âges
Côtoyer une femme plus âgée, qui a déjà traversé plusieurs vies, peut faire sauter bien des verrous. On se sent moins seule, moins “à côté de sa vie”, moins en décalage avec les injonctions. Ces amitiés offrent un ancrage émotionnel, une forme de permission implicite d’être soi sans pression de performance. Catheline, sur notre compte Instagram le formule très clairement, «Au travail, j’ai toujours été plus proche des femmes plus âgées. Une partie des collègues du même âge que moi se mettent toujours en compétition, et c’est lassant».
Ces relations créent un espace, loin de la comparaison ou du regard social. Le blog The Nonlinear Life l’a bien analysé, ces relations intergénérationnelles stabilisent le sentiment d’appartenance, redonnent de l’énergie et — surtout — allègent ce poids sourd du « retard à rattraper ». Dans une société obsédée par la vitesse, vieillir aux côtés d’autres femmes, c’est parfois ralentir ensemble, avec grâce. Et ce besoin de continuité, Sabine le formule. « J’en ai plein [d’amies plus âgées]… Mais je me dis qu’un jour je vais me retrouver seule. Alors je cherche aussi des amies de mon âge ou plus jeunes. »
Ces liens intimes et soutenants peuvent transformer en profondeur notre rapport au temps, à nous-mêmes, à ce qui nous attend. Dans Business Insider, Heather Rose Artushin raconte sa rencontre avec Toni, 84 ans, une voisine devenue au fil des mois une amie précieuse. Leur cinquante ans d’écart n’ont rien empêché, bien au contraire. Toni, avec sa vitalité, sa curiosité et son humour, a offert à Heather une autre manière d’envisager le vieillissement. « Elle m’a aidée à libérer mes peurs de vieillir… sa vitalité et sa curiosité m’ont inspirée à vivre pleinement chaque jour. »
L’amitié comme pratique féministe
Il suffit parfois d’un cercle de parole, d’un atelier ou d’un projet de recherche participatif pour que le dialogue entre générations devienne un levier de transformation. En France, plusieurs initiatives en milieu académique montrent que les liens intergénérationnels entre femmes ne sont pas un supplément d’âme, mais bien un moteur de pensée collective et critique.
La sociologue Françoise Le Borgne‑Uguen, professeure à l’Université de Bretagne‑Occidentale et spécialiste de la gérontologie féminine, mène depuis plusieurs années des projets où des femmes retraitées collaborent avec des étudiantes et des chercheuses. Ces dispositifs participatifs visent à croiser les savoirs expérientiels avec les savoirs académiques. Dans une note publiée dans Lectures (OpenEdition), elle rappelle que ces rencontres permettent de revaloriser la parole des femmes âgées, souvent invisibilisée, tout en créant les conditions d’un savoir partagé, horizontal, loin des hiérarchies classiques de l’université. « Ce que ces femmes âgées donnent à voir et à dire, c’est une capacité à interroger la norme, à transmettre des formes d’existence en dehors des modèles dominants. »
Ce renversement du regard sur la vieillesse est aussi au cœur de publications comme Les essentiels des villes amies des aînés, qui documentent comment la parole des femmes de plus de 60 ans enrichit les approches féministes contemporaines, notamment dans les champs du soin, de la transmission et de la mémoire collective.
Pourtant, ce lien entre générations n’a pas toujours été évident dans l’histoire des luttes féministes. Le vieillissement des femmes a longtemps été relégué au second plan, voire ignoré. Dans La guerre des générations aura-t-elle lieu ?, le sociologue Serge Guérin et le philosophe Pierre-Henri Tavoillot rappellent qu’il a fallu du temps pour que la sororité intègre pleinement les femmes âgées. Une absence qui a laissé des traces.