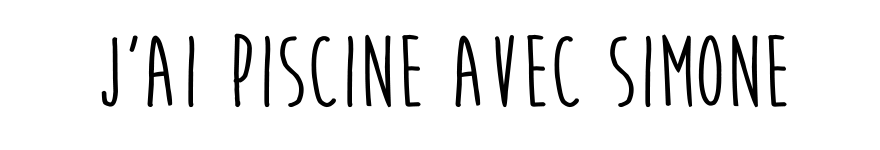À Nuuk, Mette Frederiksen a présenté des excuses officielles aux femmes inuit soumises, entre les années 1960 et 1990, à des poses de stérilets et autres méthodes contraceptives sans consentement. Ce geste inédit reconnaît un passé colonial longtemps passé sous silence et ouvre la voie à un fonds de réparation attendu par les victimes.
À Nuuk, capitale du Groenland, l’émotion était palpable le 24 septembre. Devant un parterre de femmes venues témoigner, la Première ministre danoise Mette Frederiksen a pris la parole pour refermer un chapitre longtemps passé sous silence.« Aujourd’hui, il n’y a qu’une seule chose à vous dire : pardon pour l’injustice qui vous a été faite parce que vous étiez Groenlandaises » a-t-elle déclaré émue. Ce geste officiel reconnaît une politique menée des années 1960 au début des années 1990, la pose massive de dispositifs contraceptifs sur des adolescentes et des femmes inuites, souvent sans consentement éclairé, dans un territoire alors sous administration danoise.
Cette histoire porte un nom au Danemark : la « spiralkampagnen » — la « campagne des spirales ». Son objectif affiché était de limiter les naissances dans un Groenland jugé « trop peuplé pour ses ressources » par les autorités coloniales. En réalité, il s’agissait d’un contrôle démographique déguisé en politique de santé publique. Un rapport conjoint Danemark-Groenland, publié à l’été 2025, estime qu’à la fin des années 1970, près de la moitié des femmes en âge de procréer portaient un stérilet posé dans un cadre médical qui ne laissait guère de place au choix. Pour l’historienne groenlandaise Aviaja Lennert, ces actes « n’avaient rien d’une mesure de santé publique, c’était du contrôle démographique ».
Des vies marquées par le silence
Longtemps, les victimes se sont tues, par honte ou parce qu’aucune voie de recours n’existait.
Naja Lyberth avait 13 ans lorsqu’un stérilet lui a été posé à l’hôpital, sans explication. Aujourd’hui figure centrale de la mobilisation, elle raconte à la télévision publique danoise DR : « On ne nous a rien expliqué. J’ai porté cela en silence toute ma vie. ». D’autres femmes disent avoir souffert de douleurs chroniques, d’infections, voire d’infertilité après ces interventions.
L’enquête publique s’est appuyée sur plus de 350 témoignages et des milliers de dossiers médicaux. Elle a conduit à cette reconnaissance politique. Mais pour les victimes, les mots ne suffisent pas. Le gouvernement danois a annoncé la création d’un fonds de réconciliation, sans en préciser le montant. Plusieurs associations réclament environ 300 000 couronnes danoises (40 000 €) par victime. « Les mots comptent, mais ils doivent être suivis d’actes. Nous voulons des réparations et l’accès à nos dossiers médicaux », insiste Naja Lyberth.
Déjà, 143 femmes ont déposé plainte contre l’État danois pour violation de leurs droits humains. Le Premier ministre groenlandais Jens-Frederik Nielsen a salué « un premier pas important », tout en rappelant que « les blessures coloniales ne se referment pas avec un simple pardon ».