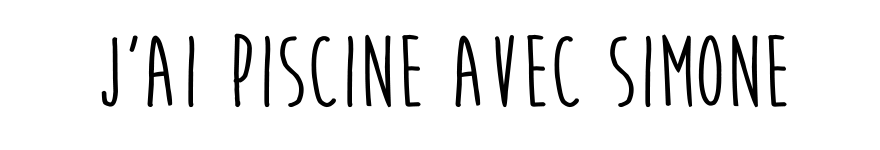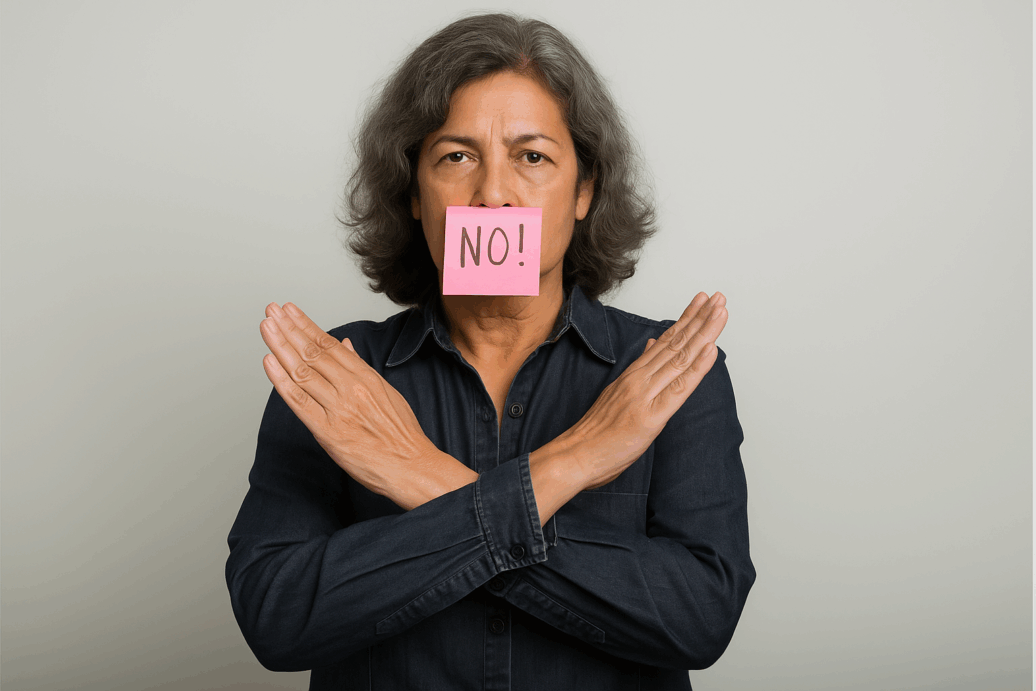Adopté le 23 octobre 2025 à une large majorité à l’Assemblée nationale, le texte inscrivant le non-consentement dans la définition du viol marque une évolution majeure du droit pénal français. Seuls les députés du Rassemblement national et du groupe Union des droites pour la République n’ont pas voté pour. Le texte doit désormais être examiné par le Sénat le 29 octobre.
Jusqu’ici, l’article 222-23 du Code pénal définissait le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle […] commis par violence, contrainte, menace ou surprise ».Cette formulation exigeait que la victime prouve une forme de résistance, physique ou verbale, pour que le viol soit reconnu. Le texte adopté le 23 octobre change profondément cette logique. Il introduit la notion de non-consentement et précise que « le consentement doit être libre, spécifique et révocable » ajoutant qu’il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de résistance. Pour la députée écologiste Marie-Charlotte Garin, l’une des rapporteures du texte, « Cette loi rappelle une évidence : le consentement doit être éclairé, et les circonstances qui l’entourent comptent. »
Plusieurs associations engagées contre les violences sexuelles ont salué l’adoption du texte comme une étape décisive. Le Mouvement du Nid a rappelé que la réforme répondait à une nécessité de clarté juridique, en précisant que le consentement devait désormais être « libre et éclairé » et ne pouvait être déduit du silence ou de l’absence de réaction. De son côté, l’Association contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT) a souligné l’importance d’accompagner ce changement législatif par une évolution des pratiques judiciaires et de la formation des magistrats. Toutes insistent sur un même point, sans moyens et sans formation, cette avancée restera symbolique.
Le non consentement à l’échelle européenne
En inscrivant le non-consentement dans la loi, la France s’aligne sur une évolution déjà engagée dans plusieurs pays européens. La Suède a ouvert la voie en 2018, en établissant qu’un acte sexuel sans consentement constitue un viol. Le Danemark lui a emboîté le pas en 2021, suivi par la Belgique et l’Espagne en 2022, qui ont intégré dans leur législation la notion de consentement explicite. Ces réformes s’inspirent de la Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe, adoptée en 2011, qui invite les États membres à définir le viol à partir de l’absence de consentement plutôt qu’à partir de la contrainte. Avec ce vote, la France rejoint ainsi un cadre juridique désormais majoritaire en Europe.
Si la réforme marque une avancée majeure, son application dépendra de la capacité des institutions à en traduire les principes dans les pratiques. En France, plus de 86 % des plaintes pour viol sont encore classées sans suite, faute d’éléments matériels ou de reconnaissance de la sidération des victimes. L’avocate Elsa Fabing rappelle dans un post Linkedin que 122 600 victimes de violences sexuelles ont été enregistrées en 2024, et qu’environ 10 % seulement portent plainte. Ces données illustrent l’écart persistant entre la réalité des violences et leur traitement judiciaire. Pour accompagner la réforme, le gouvernement prévoit la mise en place d’une formation spécifique sur la notion de consentement à destination des magistrats et des enquêteurs, ainsi qu’une révision de la grille d’évaluation des plaintes.
Au-delà du changement juridique, cette réforme interroge la culture du consentement elle-même. En reconnaissant enfin que le viol n’est pas une question de résistance mais de volonté, le Parlement ouvre la voie à une transformation plus profonde, celle d’une société où l’éducation, la justice et les institutions apprennent à écouter ce que signifie vraiment un “non”.