Le 15 octobre 2025, Anna-Karin Hatt a annoncé sa démission de la présidence du Centrepartiet (Parti du Centre). En cause, la haine et les menaces subies depuis sa prise de fonctions. Un départ qui dépasse la politique suédoise. Il interroge le coût du pouvoir féminin dans un climat de sexisme et de violence numérique.
Mardi 15 octobre 2025, Anna-Karin Hatt annonce qu’elle renonce à la présidence du Centrepartiet cinq mois seulement après sa prise de fonctions. Motif invoqué,« la haine et les menaces » qui se sont intensifiées au fil des semaines. Elle ne briguera pas de nouveau mandat et passera la main en novembre, lors du congrès de Karlstad a confirmé la radio nationale suédoise. Le soir même, La présidente démissionnaire a mis en mots l’enjeu démocratique : « l’hostilité et la polarisation dissuadent des citoyens “et pas des moindres, les femmes” de s’engager ». Un signal alarmant, alors que le pays se prépare à une année électorale.
La Suède mesure depuis longtemps la pression exercée sur ses élu·es. Selon Brå, l’Agence nationale suédoise de prévention du crime, près de 30 % des responsables politiques ont déclaré avoir subi menaces ou harcèlement en 2022, avec un écart de genre, 29,7 % des femmes contre 27,3 % des hommes. Ces menaces sont davantage personnelles et sexualisées contre les femmes, relèvent les analyses et témoignages relayés par les médias nationaux.
Le précédent Annie Lööf reste dans les mémoires suédoises. Ancienne cheffe du Centrepartiet, qu’elle a dirigé pendant onze ans avant Anna-Karin Hatt, elle avait été la cible d’un projet d’assassinat en 2022, lors d’un grand rendez-vous politique suédois organisé chaque été sur l’île de Gotland. À l’annonce du départ d’Hatt, Annie Lööf a réagi sur Facebook : « J’ai déjà été face à face avec un homme qui avait planifié de me tuer ». Ses mots disent tout du climat de peur et de violence qui pèse aujourd’hui sur les femmes en politique.L’affaire avait profondément marqué le pays et ravivé la question de la sécurité des femmes en politique.
À l’échelle internationale, l’Union interparlementaire (IPU)et le Parlement européen documentent une « violence politique genrée » : insultes sexistes, menaces de violences sexuelles, diffusion en ligne d’informations personnelles (doxxing), harcèlement en meute. Ces phénomènes découragent l’entrée et la rétention des femmes en politique et appauvrissent le débat démocratique.
Pourquoi cela fait reculer l’égalité (et la qualité du débat)
Les démissions forcées affaiblissent la représentation féminine, limitent la pluralité des voix et banalisent l’intimidation comme instrument politique — un phénomène déjà dénoncé dans le mouvement #MeTooPolitique. Le message est sans équivoque pour les femmes qui continuent de payer plus cher l’accès au pouvoir, au prix de leur sécurité, de leur intimité et de leur tranquillité. Pour les auteurs de menaces, au contraire, la démission devient une victoire silencieuse, la preuve que la pression fonctionne. Chaque départ sous contrainte renforce ainsi le patriarcat, en confirmant que le pouvoir demeure un espace hostile à celles qui le disputent.
Ce phénomène traverse les frontières. En Irlande, une étude menée par l’Université de Galway. Au Royaume-Uni, près de la moitié des candidat·es aux élections locales de 2024 déclarent avoir subi insultes ou intimidations, avec une surexposition des femmes. Dans tous les cas, la mécanique est la même, plus les femmes accèdent au pouvoir, plus la violence patriarcale se réarme.
Quitter n’est pas “faiblir” : d’autres trajectoires récentes
Mais tout départ ne s’explique pas par la violence. En 2023, la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern annonçait sa démission en invoquant l’épuisement, « je n’ai plus assez dans le réservoir ». Sa décision a cristallisé un débat mondial sur la soutenabilité du leadership féminin sous forte exposition. Mais son mandat avait aussi été miné par une hostilité inédite, souvent sexiste, rappelée par plusieurs médias. Ces cas s’additionnent : différentes causes mais même résultat, une attrition féminine au sommet qui interroge les structures de pouvoir autant que les mentalités.
La démission d’Anna-Karin Hatt révèle d’abord la vitesse à laquelle les femmes peuvent être fragilisées dans des fonctions de pouvoir. Six mois à peine après sa nomination, une cheffe de parti jugée compétente et consensuelle jette l’éponge. Une temporalité éclair qui interroge la solidité du système politique face aux attaques ciblées et plus encore, la capacité collective à protéger celles qui l’incarnent.
Ensuite, l’affaire met en lumière un schéma bien connu, sitôt l’annonce faite, les médias suédois se sont précipités sur la question des « successeurs » et des indemnités de départ, reléguant au second plan le débat essentiel sur la sécurité des élues et la régulation des plateformes. Autrement dit, le récit politique absorbe la défection féminine sans jamais interroger les causes structurelles qui la provoquent. Enfin, les études menées par Brå montrent combien cette hostilité produit une dissuasion silencieuse. De nombreuses élues s’autocensurent, évitent certains sujets sensibles (immigration, violences sexuelles, écologie) par crainte des représailles en ligne. Ce chilling effect, ou refroidissement du débat public, appauvrit la démocratie autant qu’il invisibilise les femmes.
Quelles réponses pour que les femmes ne restent pas seules au front ?
Du côté des géants du web, la marge d’action existe mais elle reste sous-exploitée. les plateformes disposent déjà d’outils capables de détecter les comptes multiples, de ralentir automatiquement les vagues de messages haineux (throttling), ou encore de protéger les comptes publics menacés, notamment ceux des élues.. L’Union européenne a inscrit ces principes dans le Digital Services Act qui impose aux réseaux sociaux une responsabilité accrue face aux contenus haineux et sexistes, mais les premiers bilans d’application demeurent timides.
La réponse ne peut venir uniquement du droit ou de la technologie les partis politiques eux-mêmes doivent s’emparer du sujet. Plusieurs médias, dont Svenska Dagbladet rappellent l’urgence de créer des cellules d’appui juridique, de proposer des formations à la sécurité numérique et d’instaurer des congés-sécurité sans stigmatisation pour les élues menacées. Ces dispositifs existent déjà dans certaines entreprises, mais restent rarissimes dans les formations politiques même dans un pays pionnier en matière d’égalité, la parole féminine reste une ligne de front.
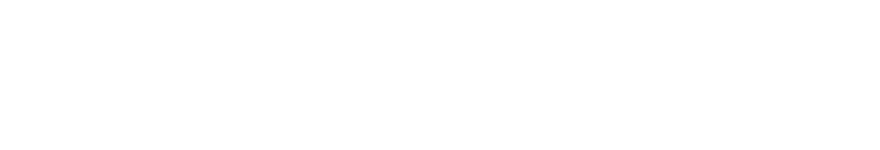




Ajouter un commentaire