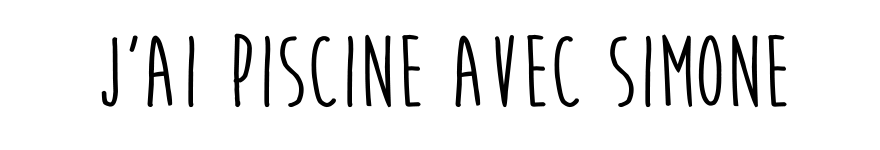En 1965, une femme mariée pouvait enfin ouvrir un compte bancaire sans l’autorisation de son mari. Soixante ans plus tard, ce droit semble acquis — mais l’égalité économique, elle, reste à consolider.
Il y a tout juste soixante ans, un décret modifiait le quotidien de millions de femmes françaises, à compter du 13 juillet 1965, une femme mariée pouvait enfin ouvrir un compte en banque et exercer une activité professionnelle sans demander l’autorisation de son mari. Une avancée légale tardive — et largement oubliée dans les manuels d’histoire — qui marque pourtant un tournant fondamental dans l’émancipation économique des femmes.
Jusqu’à cette date, le Code civil plaçait les femmes mariées sous la tutelle maritale. Elles ne pouvaient ni signer un contrat de travail, ni encaisser leur propre salaire, ni disposer librement de leurs biens. Cette inégalité n’était pas qu’une abstraction juridique : elle se vivait dans les faits, au quotidien. « Les femmes mariées avaient le même statut que les mineurs ou les incapables majeurs », rappelle le site officiel du gouvernement. La loi de 1965, portée par le ministre de la Justice Jean Foyer, met fin à cette dépendance financière inscrite dans la loi. C’est peu dire qu’il s’agit là d’un jalon essentiel sur le chemin de l’égalité, même si d’autres verrouillages — salariaux, patrimoniaux ou sociaux — perdurent.
Droit bancaire et dépendance économique : l’égalité en pointillés
Aujourd’hui encore, les traces de cette tutelle économique se font sentir. Selon un sondage relayé par Madame Figaro, 23 % des Françaises n’ont pas de compte bancaire à leur nom. Et lorsqu’elles en possèdent un, elles sont proportionnellement moins nombreuses que les hommes à disposer d’une épargne, à investir, ou à ouvrir un produit de placement. En 2024, seules 14 % des femmes détiennent une assurance-vie contre 28 % des hommes. L’écart se creuse encore sur les portefeuilles d’actions, les plans d’épargne en actions (PEA) ou les biens immobiliers.
À cette inégalité d’accès aux outils financiers s’ajoutent des pratiques successorales encore déséquilibrées. Comme nous l’avons montré dans un post Instagram récent, les femmes héritent en moyenne 20 % de moins que les hommes, selon une analyse du courtier Pretto publiée en 2024. Les donations anticipées — c’est-à-dire les dons faits du vivant des parents — profitent également davantage aux hommes : 2,2 fois plus que pour les femmes. Pis encore : 52 % des femmes héritent en usufruit, un statut qui leur permet d’utiliser un bien sans en avoir la pleine propriété ni le pouvoir de transmission.
Ces constats font écho aux travaux de Céline Bessière et Sibylle Gollac dans Le genre du capital. Les deux sociologues soulignent que, malgré le vernis égalitaire, les choix familiaux perpétuent une inégalité structurelle : « Les “biens structurants”, comme les entreprises familiales ou les maisons de famille, sont plus souvent confiés à des fils, tandis que les filles se voient offrir des compensations monétaires de valeur souvent inférieure. » Une logique de reproduction du capital masculin qui agit dans l’intimité des familles comme dans les bilans de patrimoine.